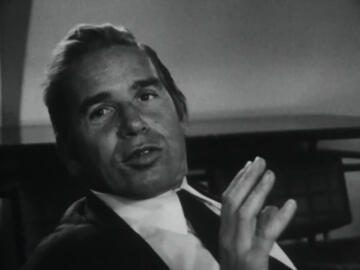Adoptée par l’Assemblée nationale le 27 juillet 1982, la loi allait être promulguée le 4 août suivant. La loi Forni, du nom du député Raymond Forni - alors jeune président de la commission des lois et futur président de l’Assemblée nationale - qui avait déposé le projet de loi dès novembre 1981. Soutenu par Robert Badinter et rapportée par Gisèle Halimi, il devait abroger le « délit d’homosexualité ». Ce délit ancien datait d’une disposition du Code pénal (l’alinéa 2 de l’article 331 du Code pénal), née sous le régime de Vichy. Il pénalisait certaines relations homosexuelles et condamnait « les actes contre-nature » et les relations entre hommes de moins de 21 ans. Il aggravait de fait les peines en cas « d’attentat aux mœurs sur mineurs », lorsqu’il était commis par une personne de même sexe.
La suppression de ce texte était une promesse de campagne du candidat François Mitterrand. La proposition de loi de la gauche visait à remettre au même niveau les âges de consentement pour les relations sexuelles, que l'on soit hétérosexuel ou homosexuel. La distinction discriminatoire dans l’âge entre rapports homosexuels et hétérosexuels fut ainsi supprimée officiellement à la promulgation de la loi. Ce fut une victoire et un soulagement pour les milieux LGBT. La loi du 4 août 1982 mettait un terme à des décennies de stigmatisation pour les gays et lesbiennes.
Le 27 juillet 1982, à l’annonce du vote de l’Assemblée nationale, Didier Varrod, le secrétaire général de la radio Fréquence Gaie, était venu sur le plateau du journal de la nuit d'Antenne 2 pour expliquer ce que signifiaient la disparition du délit d'homosexualité et la disparition de la discrimination légale. Il remerciait notamment le Comité d'Urgence anti-répression homosexuelle qui avait fait un grand travail sur le sujet depuis trois ans. Il soulignait également que la radio Fréquence Gaie continuerait son combat concernant l'évolution des mentalités, car, expliquait-il, il y avait encore « un énorme travail à faire encore de ce côté-là ». Exprimant son sentiment de liberté retrouvée, il employait le terme fort de « ghetto » pour signifier l'ampleur de la répression officielle et des discriminations subies par les homosexuels durant ces décennies.
Un long travail préparatoire
Bien avant son arrivée au pouvoir, François Mitterrand avait demandé à Robert Badinter, son futur garde des Sceaux, de travailler sur la notion de liberté et notamment de liberté sexuelle. Dans une interview de 1976, à l’occasion de la sortie de son livre Libertés Libertés, écrit par le Comité pour une charte des libertés dont il est l'animateur. L’avocat s'exprimait déjà sur la question, évoquant les réflexions menées sur la liberté et les droits au corps (sauvegarde et épanouissement) des individus. Il soulignait notamment la nécessité de défendre les droits des homosexuels.
Livre de chevet : liberté libertés
1976 - 03:26 - vidéo
Durant sa préparation, le texte de loi avait été largement soutenu par les associations LGBT comme le soulignait Didier Varrod en tête d’article. En juin 1982, 15 000 militants homosexuels et militantes lesbiennes avaient ainsi défilé dans Paris pour lutter contre les discriminations et réclamer la suppression de « la loi anti-homosexuelle vestige du gouvernement fasciste de vichy ».
Manifestation homo
1982 - 01:16 - vidéo
Entre 1942 et 1982, plus de 10.000 personnes ont été condamnées pour des actes homosexuels, estime Régis Schlagdenhauffen, maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS).
Pour aller plus loin :
Etre homosexuel en France en 1979. Reportage diffusé dans « Question de temps » sur | A2 , le 4 novembre 1979, sur l'homosexualité masculine constitué à partir d'interviews de douze homosexuels qui ont décidé de vivre au grand jour leur orientation. Ils viennent de tout les milieux et de toute condition sociale : Jean-Pierre est architecte, Dominique Fernandez, écrivain et professeur, Didier est étudiant, Hervé ouvrier ou encore François, un agriculteur. Tous racontent leur parcours, le regard des autres, la réaction de leur famille, leurs doutes et leur colère face à l’intolérance de la société française.